
0.L’Ecole des Roches
L’Ecole des Roches de 1899 à nos jours : Evolutions d’une école nouvelle, du prototype au lieu de mémoire.
Dès sa création, l’Ecole des Roches s’est inscrite dans un projet pédagogique sciemment défini : former de futures élites. École privée d’enseignement secondaire, fondée en 1899 en Normandie, dans l’Eure, près de la petite ville de Verneuil-sur-Avre, son recrutement est d’abord uniquement réservé à des garçons appelés, du fait de leur origine sociale, à intégrer les classes dirigeantes du pays. Devenue mixte en 1969, elle existe toujours aujourd’hui. Elle a célébré avec faste son centenaire dans le cadre de son vaste domaine de 60 hectares.
Première partie : l’Ecole des Roches et la formation des élites à la Belle Epoque.
I De nouvelles élites pour réformer la société française :
L’Ecole des Roches a été fondée par un sociologue, Edmond Demolins, qui souhaitait réformer la société française par de nouvelles élites. Sa théorie s’appelle le particularisme ; inspirée du Leplaysien Henri de Tourville, elle distingue deux grands types de sociétés humaines : - les sociétés à formation communautaire (famille, tribu, pouvoirs publics, état providence....) et les sociétés à formation particulariste, où les individus sont habitués à ne compter que sur eux-mêmes. Ces deux types de sociétés lui paraissent réparties géographiquement : les sociétés communautaires correspondent au monde latin, tandis que le type particulariste correspond au monde anglo-saxon (le Nord et l’ouest de l’Europe). Edmond Demolins fait de l’Ecole des Roches l’application éducative de cette théorie sociologique. Son but est de former des individus qui ont une mentalité particulariste, au sein d’un pays à formation communautaire. Edmond Demolins est catholique et conservateur. En 1899, il publie un livre qui s’intitule A quoi tient la supériorité des anglo-saxons ?. Traduit en huit langues, il connaît un énorme succès. Décrivant le fonctionnement de deux écoles nouvelles qui entendent réformer les « publics schools », en Angleterre, il va introduire le concept d’éducation nouvelle en France où, à cette époque, l’enseignement secondaire fait l’objet de critiques sévères, l’enseignement classique étant jugé inadapté au développement économique de la France et trop centré sur la formation des fonctionnaires alors que le pays a de plus en plus besoin d’entrepreneurs. L’Ecole des Roches est une entreprise totalement privée dont les actionnaires sont de riches industriels. Toutes les infrastructures vont être construites. Elle se présente comme un laboratoire pédagogique d’avant-garde, indépendante de l’Eglise et de l’État, tout en étant privée et laïque.
II Prototype de l’éducation nouvelle en France :
“ L’esprit rocheux ” désigne l’apprentissage d’une vie en communauté :
 vie en communauté : l’internat
vie en communauté : l’internat
 une ambiance familiale, dans des maisons animées par des « chefs de maison » et disposées autour du bâtiment central où ont lieu les cours
une ambiance familiale, dans des maisons animées par des « chefs de maison » et disposées autour du bâtiment central où ont lieu les cours
 le capitanat, spécificité de l’éducation rocheuse : la discipline est assurée par de grands élèves appelés « capitaines », suppléés par des « sous-capitaines », ce qui supprime la présence des surveillants. Le but est d’amener les élèves à prendre en main leur école en adhérant à une autodiscipline. Premier aspect d’une éducation active.
Mais il s’agit aussi d’une éducation totale car elle vise à former un homme complet sur tous les plans : intellectuel, physique et moral. L’emploi du temps est ainsi divisé en trois parties :
le capitanat, spécificité de l’éducation rocheuse : la discipline est assurée par de grands élèves appelés « capitaines », suppléés par des « sous-capitaines », ce qui supprime la présence des surveillants. Le but est d’amener les élèves à prendre en main leur école en adhérant à une autodiscipline. Premier aspect d’une éducation active.
Mais il s’agit aussi d’une éducation totale car elle vise à former un homme complet sur tous les plans : intellectuel, physique et moral. L’emploi du temps est ainsi divisé en trois parties :
 la matinée est réservée aux apprentissages scolaires avec l’accent mis sur l’apprentissage des langues, l’expérimentation, la méthode inductive...
la matinée est réservée aux apprentissages scolaires avec l’accent mis sur l’apprentissage des langues, l’expérimentation, la méthode inductive...
 l’après-midi, aux travaux pratiques (jardinage, menuiserie, forge, dessin, sculpture...) et aux activités sportives (sports collectifs ou individuels....). Les travaux pratiques sont conçus pour initier les élèves aux qualités de patience, de soin... et également pour familiariser ces futurs patrons aux métiers que pratiqueront leurs ouvriers.
l’après-midi, aux travaux pratiques (jardinage, menuiserie, forge, dessin, sculpture...) et aux activités sportives (sports collectifs ou individuels....). Les travaux pratiques sont conçus pour initier les élèves aux qualités de patience, de soin... et également pour familiariser ces futurs patrons aux métiers que pratiqueront leurs ouvriers.
 la fin d’après-midi, la soirée et les samedis et dimanches sont consacrés aux activités culturelles et artistiques (le chant, la musique, la lecture, les conférences.......) et, le dimanche tout particulièrement, à la pratique religieuse.
L’Ecole des Roches est un établissement laïque qui prend en compte l’éducation religieuse de ses élèves, dans un esprit cuménique, ce qui est une originalité pour l’époque. Elle accueille en effet des élèves catholiques mais aussi protestants.
Toutes ces activités scolaires et périscolaires contribuent à définir l’éducation rocheuse comme élitiste, quoique la notion d’élite ait sensiblement changé de sens depuis le fondateur Edmond Demolins jusqu’au directeur Georges Bertier.
la fin d’après-midi, la soirée et les samedis et dimanches sont consacrés aux activités culturelles et artistiques (le chant, la musique, la lecture, les conférences.......) et, le dimanche tout particulièrement, à la pratique religieuse.
L’Ecole des Roches est un établissement laïque qui prend en compte l’éducation religieuse de ses élèves, dans un esprit cuménique, ce qui est une originalité pour l’époque. Elle accueille en effet des élèves catholiques mais aussi protestants.
Toutes ces activités scolaires et périscolaires contribuent à définir l’éducation rocheuse comme élitiste, quoique la notion d’élite ait sensiblement changé de sens depuis le fondateur Edmond Demolins jusqu’au directeur Georges Bertier.
III Rayonnement et limites :
Par son prix de pension élevé, l’Ecole des Roches s’affirme comme un rendez-vous des hautes bourgeoisies et aristocraties françaises et étrangères. Elle accueille également une importante minorité protestante. Cette bonne société se distingue par une sociabilité mondaine : les Roches forment au « self-government » mais apprennent aussi à ses élèves se comporter en « gentlemen ». À la suite de l’Ecole des Roches, d’autres écoles nouvelles vont être créées dans les années 1900/1910 : l’Ecole d’Ile de France, à la suite d’un schisme dans le corps professoral de l’Ecole des Roches, le Collège de Normandie créé par un groupe d’industriels ; au total une dizaine d’école jusqu’en 1914 ; certaines n’ont vécu que quelques années, et d’autres ont réussi à passer l’épreuve des deux guerres mondiales. L’Ecole des Roches qui existe toujours est la seule en France à avoir surmonté tous les aléas historiques du XXème siècle. Les anciens élèves ont constitué très tôt une association, dès 1905, pour proposer une entraide amicale et un réseau de relations professionnelles.
Deuxième partie : l’Ecole des Roches, phare français au sein de la nébuleuse de l’éducation nouvelle (1918 - 1944). En effet, sous l’action de Georges Bertier, directeur de 1903 à 1944, l’Ecole des Roches s’est affirmée comme un foyer de rayonnement de l’éducation nouvelle.
I L’Ecole des Roches s’inscrit à la croisée de chemins franco-helvétiques incarnés par Adolphe Ferrière, Georges Bertier et Élisabeth Huguenin :
Le Genevois Adolphe Ferrière est l’un des premiers visiteurs de l’Ecole des Roches, dès l’année de son ouverture en 1899. Entre Georges Bertier et Adolphe Ferrière, il existe une relation d’estime, de confiance qui s’est traduite dans les faits par une action prosélyte pour diffuser les méthodes d’éducation nouvelle. Leur coopération conduit à la publication d’articles de Georges Bertier dans la revue "Pour l’ère nouvelle", organe francophone du Bureau International de l’Education nouvelle dont Ferrière est le rédacteur en chef entre 1922 et 1935. Ces articles portent soit sur l’Ecole des Roches, soit sur l’éducation sociale ou l’éducation morale dans le but de réformer les programmes de l’école publique. Élisabeth Huguenin est une éducatrice suisse qui va venir à l’Ecole des Roches, en tant que maîtresse de maison durant dix ans ; selon son propre témoignage, elle y connaît une expérience désenchantée tout en reconnaissant néanmoins la difficulté pour Georges Bertier de trouver un compromis entre les objectifs de l’éducation nouvelle qui vise l’éducation totale et les exigences des parents qui veulent une préparation efficace à l’examen du baccalauréat.
II Un foyer de rayonnement grâce à l’action militante de Georges Bertier :
Bertier cherche à placer l’Ecole des Roches à mi-chemin entre les avancées novatrices de l’éducation nouvelle et les exigences de la culture scolaire traditionnelle. Il essaie de trouver l’équilibre entre éducation nouvelle et humanité classique. Il s’attache à déléguer à l’enfant une partie de la gestion de la vie scolaire et il renforce l’institution des capitaines. Il encourage aussi toutes les méthodes inductives et l’observation pour rendre l’enfant acteur de l’acquisition de son savoir. Il n’ignore pas que l’université porte un intérêt à l’expérience des Roches et va savoir se placer en complémentarité avec elle. Il se présente en fervent propagandiste d’une institution scolaire qu’il considère comme un laboratoire pédagogique, certes réservée à une minorité fortunée, mais dont il espère que les innovations éducatives vont contribuer à la modernisation de l’Instruction publique.
Conclusion : La stratégie de Bertier pour diffuser le modèle éducatif des Roches ne peut se comprendre que dans une optique sociale : assurer la paix entre les classes sociales. Il veut former des élites dans un sens leplaysien, des élites que l’on peut former dans toutes les catégories sociales. Le scoutisme est utilisé aussi à cet effet, contre le socialisme.
Nathalie Duval
* * *
Pour de plus amples informations sur la vie de l’école et et son organisation administrative et éducative, nous invitons également à visiter le site de l’Ecole des Roches :
http://www.ecole-francaise.org/
Enfin, pour une histoire détaillée de l’histoire de cette école et de ses acteurs, nous vous renvoyons à la Bibliographie de l’auteur de cet article :
Arnaud Baubérot et Nathalie Duval, Le scoutisme entre guerre et paix, Paris, L’Harmattan, 2006, 244 pages. Nathalie Duval, « L’Ecole des Roches, phare français au sein de la nébuleuse de l’éducation nouvelle (1899-1944) », Paedagogica Historica, vol.42, n°1&2, février 2006, pp. 63-75.
Nathalie Duval, « De l’Ecole des Roches à l’Outre-mer : formation et parcours délites françaises (de 1899 aux années 1950) », sous la direction de Sarah Mohamed-Gaillard et Marie Romo-Navarrete, Des Français d’Outre-mer, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne (PUPS), collection Roland Mousnier, 2004.
Nathalie Duval, « L’Ecole des Roches dans les années 1960 : une institution en crise », L’Education nouvelle, histoire, présence et devenir, Peter Lang, Berne, 2004, pp. 271-295.
Nathalie Duval, « Le réseau des formations scolaires. L’exemple de l’Ecole des Roches », sous la direction de Marc Fumaroli, Gabriel de Broglie, Jean-Pierre Chaline, Elites et sociabilité en France, Paris, Perrin, 2003, pp. 185-199.
Nathalie Duval, « L’adolescence des élites à l’Ecole des Roches : capitanat, sport et spiritualité (de 1899 à 1965) ». Lorsque l’enfant grandit, entre dépendance et autonomie, sous la direction de Jean-Pierre Bardet, Jean-Noël Luc, Isabelle Robin-Romero et Catherine Rollet, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003, pp. 559-572 ; colloque organisé à la Sorbonne, du 21 au 23 septembre 2000.
Nathalie Duval et Patrick Clastres, « Bien armé pour la vie ou Français je suis. Deux modèles scolaires concurrents : L’Ecole des Roches et le Collège de Normandie », Les Etudes Sociales, n°137, 1er semestre 2003, pp. 21-35.
Nathalie Duval, « L’éducation nouvelle dans les sociétés européennes à la fin du XIXème siècle », Histoire Economie Société (HES), n°1, 21ème année, 1er trimestre 2002, pp. 71-86.
Nathalie Duval, Antoine Savoye (sous dir.), « L’Ecole des Roches, un creuset d’éducation nouvelle », Les Etudes sociales, n° 127-128, 1998, 264 pages.
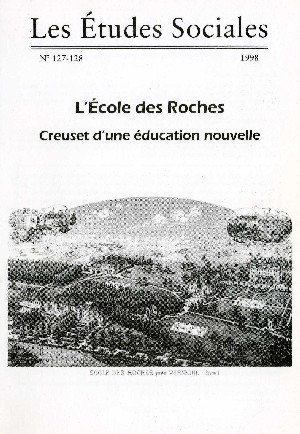
Nathalie Duval, Régis de Reyke, « Georges Bertier. Un éducateur oublié », Les Etudes sociales, 2ème semestre 1999, n°130, pp. 83-94.
Nathalie Duval, « Le rayonnement international de l’Ecole des Roches, 1899-1999 », Etudes normandes, n°4, 1999, pp. 35-62.
Nathalie Duval, « Le Collège de Normandie, un collège à l’anglaise dans la campagne normande. 1902-1972 », Etudes normandes, n°3, 1992, pp. 39-50.
Nathalie Duval, "L’Ecole des Roches et le Collège de Normandie : des « écoles nouvelles » pour les élites de 1899 à 2006", thèse de doctorat en histoire sous la direction du Professeur Jean-Pierre Chaline (Paris IV-Sorbonne), novembre 2006.
Pour toutes questions et autres renseignements, vous pouvez contacter Nathalie Duval via son adresse net : nathalie.duval@paris-sorbonne.fr
Forum
-
23 mars 2009, par Jean-Pierre Desthuilliers
Bonjour
L’Ecole des Roches a formé "des générations" de jeunes français en usant de méthodes pédagogiques maintenant bien connues, du moins par ouvrages, colloques, témoignages interposés.
Elle au aussi essaimé et ses anciens élèves, comme certains de ses enseignants, ont créé des établissements d’enseignement-éducation peu connus, et s’inspirant largement de ses principes directeurs.
J’ai ainsi passé deux années de ma vie, entre 1951 et 1953, à l’Ecole du Gai Savoir de Michel et Genviève Bouts. Le père de Michel Bouts avait été administrateur délégué de la Société de l’Ecole Nouvelle et le resta près de vingt-cinq ans. Michel Bouts, né en 1902, passa plusieurs années à l’école des Roches puis, après un intermède monastique, s’impliqua dans la création, vers 1929, de l’école Saint Martin à Pontoise. Il y fut chef de maison jusqu’à la guerre. En 1943, il créa l’école du Gai Savoir, localisée à Neauphle-le-Vieux, puis à Dingé, et enfin à Bazouges-la-Pérouse, jusque vers 1975.
J’ai donc personnellement vécu "de l’intérieur" les particularités de cette pédagogie qui voulait concilier une approche personnaliste responsabilisante et une intégration communautaire fraternelle. Et y avoir goûté après avoir passé deux ans au collège Albert de Mun, qui incarnait de manière presque caricaturale les particularité de la discipline religieuse appliquée à l’inculcation des règles de la grammaire grecque et autres exigences du programme, m’a conduit à une réflexion personnelle sur les processus éducatifs que j’ai pu, ultérieurement, mettre en oeuvre dans mon métier de cadre dirigeant, puis de conseiller d’entreprise.
J’ai essayé d’expliciter, dans la préface que j’ai rédigée pour le roman posthume de Michel Bouts, Sang Breton (éditions Elor), ce qu’était pour moi "l’empreinte reçue et acceptée" de ces deux années de développement personnel et de socialisation . Ce roman contient aussi un témoignage de l’acteur Claude Rich, qui fût vers 1945 un des "enfants" de Michel Bouts.
Tout ce détour pour dire que "l’esprit des Roches" avait soufflé bien plus loin que les limites du domaine de Verneuil-sur -Avre...
-
24 mars 2009, par Laurent GUTIERREZ
Cher Monsieur,
Merci mille fois pour ce temoignage. Auriez vous la gentillesse de me contacter a mon adresse mail personnelle : LGutierrez76@aol.com afin que nous puissions echanger sur votre recit et faire la promotion de l’ouvrage dont vous avez redige la preface ? Dans l’attente de vous lire, Cordialement,
Laurent GUTIERREZ
-
-
31 mars 2008, par Hugo
