
10. L’Ecole des parents
En 1929, Mme Vérine fonde l’École des Parents. Cette initiative est la première de ce genre en Europe, et donne l’élan à un mouvement international qui trouve sa pleine expansion après la Seconde Guerre mondiale.
L’idée d’instruire les parents, de les aider dans leurs difficultés éducatives auprès de leurs enfants s’exprime timidement à l’aube du XXème siècle. Les premières « écoles des mères » voient le jour en Angleterre. Destinées aux mères de famille et aux jeunes filles des classes populaires, elles sont explicitement consacrées à l’hygiène et à la puériculture. Leur but principal est de lutter contre la mortalité infantile et les erreurs éducatives. Elles s’inscrivent dans le puissant courant de la philanthropie et de l’assistance sociale qui s’installe alors en Europe. En Allemagne, la première « Mutterschule », sur le même modèle, est fondée en 1917 à Stuttgart.
Ces initiatives pionnières se multiplient après la Première Guerre mondiale, en lien avec les bouleversements que celle-ci a entraînés au sein de la famille : émancipation sociale de la femme par le travail, remise en question de l’autorité paternelle, limitation volontaire de la taille de la famille, et augmentation corollaire du souci éducatif. Édouard Claparède, au tournant du siècle, a prophétisé : « Le siècle qui s’ouvre sera celui de l’enfant ». Les faits lui donnent alors raison, mais dans un contexte qu’il n’avait ni prévu ni désiré. L’Europe qui se relève de la Grande Guerre est exsangue, dépeuplée, traumatisée, désorientée, et le thème de l’enfance porteuse d’avenir et d’espérance s’impose avec force.
Mais quel avenir faut-il construire aux enfants pour que pareille catastrophe ne se reproduise jamais ?
En France, la réponse à cette question s’exprime d’abord dans une doctrine pédagogique laïque, sous la forme de l’École Unique. Il s’agit d’organiser une réforme profonde de l’enseignement où la sélection s’opère non sur la base de l’appartenance à une classe sociale, mais sur celle des aptitudes et du mérite. Que tous soient instruits et que les meilleurs, quelle que soit leur origine, soient mis à leur vraie place, la première. Ce projet soulève d’emblée une forte hostilité dans la bourgeoisie, qui craint que les moins brillants de ses rejetons ne soient éliminés du lycée au profit des enfants les plus doués des classes populaires. Ces parents s’élèvent en bloc contre un système qui, « avec la gratuité, comprendra la sélection, l’orientation obligatoire, la mise à l’écart du droit sacré des familles »1 . En 1924, l’Association catholique des chefs de famille réunit 18 000 personnes contre l’École Unique, fille dévoyée de l« État athée ».
L’autre levier de cette création est le développement considérable, au cours de la décennie vingt, des sciences humaines, et particulièrement de la psychologie et de la psychanalyse de l’enfant. L’idée que les attitudes des parents, leurs erreurs éducatives sont susceptibles d’entraîner des troubles chez l’enfant et d’entraver le développement de sa personnalité commence alors à se répandre et, corollairement, celle d’une éducation des parents, qui pourrait bien être une rééducation. Cette conception est la transcription moderne d’une tradition vivace dans la pensée pédagogique, qui remonte à Montaigne et à Rousseau et est maintenant reprise par le philosophe Alain. Selon elle, les parents sont de piètres éducateurs, au mieux des alliés silencieux, au pire des gêneurs, des ignorants, des arriérés. Alors qu’ils étaient jusque-là un élément ignoré des responsables des institutions sociales, pédagogiques et sanitaires, les parents reviennent sur le devant de la scène, le plus souvent en posture d’accusés. Georges Heuyer l’exprime sans ambages (Heuyer, 1926) dans sa leçon inaugurale du cours annexe de la clinique de neuropsychiatrie infantile :
« En toutes circonstances, nous rencontrerons un obstacle que nous devons connaître : je veux parler des parents de nos enfants. Nous utiliserons les débiles, nous amenderons les pervers, mais je doute que nous modifiions jamais l’état d’esprit des parents. . Le rôle des parents pour Heuyer est nocif à double titre : ils transmettent une mauvaise hérédité et une mauvaise éducation. Évidemment, les enfants dont s’occupe l’aliéniste sont plus souvent des enfants de prolétaires que des enfants de la bourgeoisie.
Enfin, pour conclure ce tableau du contexte d’émergence de l’École des Parents, il faut rappeler que l’année 1929 marque le début de la crise économique. Tout au long des années trente, le thème plus global de la crise, du déclin de l’Occident, de la dégénérescence du corps social revient de manière obsessionnelle. Face au déclin de l’autorité, de la spiritualité, de la race, de la France, une partie de la droite brandit l’arme du redressement et du réarmement moral, grâce à l’idéal familial. La « famille française normale », c’est-à-dire catholique et nombreuse, est présentée comme le dernier rempart contre l’esprit de jouissance, le « faux égalitarisme niveleur », le goût du moderne, de l’immédiat, qui conduisent la nation sa perte. C’est sur ce terreau que va naître et grandir l’œuvre de Mme Vérine.
* Université de Paris VIII-Saint-Denis. Ce texte reprend des éléments d’un article paru dans le Bulletin de psychologie ,53, 5, septembre-octobre 2000, p 635-642.
1.Louis Marin, débat parlementaire.
Pour plus d’informations sur les activités de l’Ecole des parents, nous vous invitons à consulter leur site :
http://www.ecoledesparents.org/fnepe/index.html
Publications de l’auteur de cet article :
1-Publications dans des revues avec comité de lecture
« Les médecins hygiénistes français face à la politique raciale allemande. 1933-1939 », L’Évolution psychiatrique, 2001 ; 66, p. 348-356.
« L’émergence d’un mouvement sexologique français (1929-1939), entre hygiéniste, eugénisme et psychanalyse. » PSN (Psychiatrie, Sciences humaines et Neurosciences), n°4, septembre.-octobre 2003, p. 50-61.
« Die psychoanalytische Bewegung in der französichen Nachkrieggesellschaft (1945-1953) . Allianzen und Brüche“. Osterreichische Zeitschrift für Geschichtwissenschaften, Heft 2, 2003, p.86 -107.
« Qu’éclaire la lampe de Psyché ? » Psychologie clinique, 17,2004 /1, p.77-83.
« Le devenir des enfants suivis en psychiatrie : premières enquêtes rétrospectives d’évaluation,L’Evolution psychiatrique 69 (2004) 589-603.
2-Chapitres d’un ouvrage collectif
Dictionnaire international de la psychanalyse, Calmann-Levy, 2002, sous la direction d’Alain de Mijolla. Textes rédigés : l’Année psychologique - Les Archives de psychologie - Dalbiez Roland - Janet Pierre - Jankélevitch Samuel - Le Bon Gustave - Meyerson Ignace - Subconscient. Manuel “Psychologie clinique”, tome II, Lexifac-Bréal, 2002. Fiches rédigées : “La notion de perversion instinctive” ; “Une psychologie sociale clinique ?” ; “La querelle des tests”.
« Une querelle revisitée, celle des applications de la psychanalyse à l’éducation » In Ohayon A.,Ottavi D., Savoye A.(ed) L’Education Nouvelle, histoire,présence et devenir. Ed. Peter Lang, Genève, Juillet 2004, p 185-210.
« Emergence de la psychologie clinique en France : autour de l’œuvre de Daniel Lagache » in Raoult P.A.(sous le dir.) De la disparition des psychologues cliniciens ,L’Harmattan, 2004, p11-25.
« L’autobiographie des psychologues au féminin et au masculin : Bianka et René Zazzo, un couple de psychologues dans le siècle(1930-2000) » in Carroy J., Edelman N., Ohayon A., Richard N. Les femmes dans les sciences de l’homme(XIXème-Xxème siècle) Seli Arslan 2005.
« Charles Baudouin pelmaniste 1929-1939 » dans Ruchat Martine et Magnin Charles : « Je suis celui qu’on ne connaît pas et qui passe » Charles Baudouin (1893-1963) LEP, Lausanne 2005, p53-70.
« La jeunesse et l’adolescence dans la psychologie française (1946-1966) dans Chapoulie Jean Michel et al. (sous la dir.) Sociologues et sociologies La France des années 60 L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2005, p 163-178.
« Psychanalyse,éducation nouvelle et éducation morale dans les années 1930 en France » dans Hofstetter R. et Schneuwly B. (Éd.)Passion, fusion, tension, Education nouvelle et Sciences de l’éducation Fin du 19è-milieu du 20ème siècle Peter Lang, Bern, 2006.
Ouvrages
Psychologie et Psychanalyse en France L’impossible rencontre (1919-1969) avec une postface inédite Réed. La Découverte/poches 2006
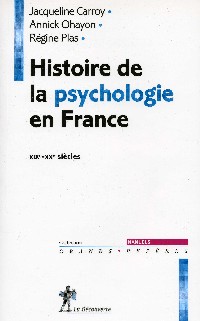
Histoire de la psychologie en France XIXe-Xxe siècle avec Jacqueline Carroy et Régine Plas, coll. Grands Repères Manuels, La Découverte, 2006.
Autres publications
« Fondements et usages des tests. Une histoire critique », Journal des psychologues, n° 186, avril 2001, p. 22-29.
« Vingt ans d’histoire de la psychologie dans le Journal des Psychologues », Journal des Psychologues, n° 200, septembre 2002, p. 24-30.
À paraître
« L’histoire bégaie-t-elle ? Exercice de la psychothérapie et monopole médical », Psycho Média, 9 juin/août 2006,p 54-59.
« La psychologie clinique en France, éléments d’histoire », Connexions 85, Juin 2006.
